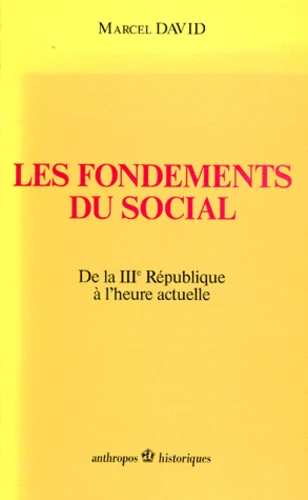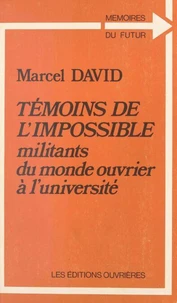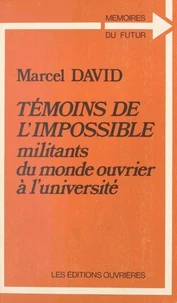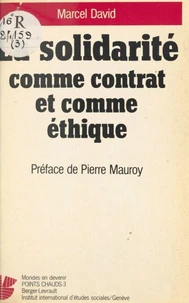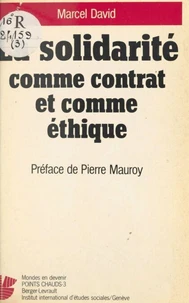Les fondements du social. De la IIIe République à l'heure actuelle
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages298
- PrésentationBroché
- Poids0.53 kg
- Dimensions15,6 cm × 24,1 cm × 1,9 cm
- ISBN2-7178-2403-0
- EAN9782717824032
- Date de parution01/01/1993
- CollectionHistoriques
- ÉditeurEconomica
Résumé
La fraternité, la solidarité et la justice, en tant que fondements du "social", ont à coexister avec les normes que la société elle-même produit. Or on sait désormais que les conflits, porteurs de violence contribuent également à vitaliser le social, tout en servant de ferment et de garant à la démocratie. Antinomie inéluctable ou possible complémentarité ? Pour sorti de ce dilemme, l'auteur commence par suivre à la trace le concept de social et par relater le déroulement du grand débat, plein d'enseignements, qui eut lieu à ce sujet de 1881 et 1910. Ce qui lui permet de mettre en évidence les oppositions qui, sous cet angle, divisent de nos jours encore les divers courants de pensée et d'action. Etant donné la dissémination du social, il a dû se limiter à l'analyse de quelques-unes de ses composantes. Ont été choisis, en priorité, le syndicalisme et l'extrême pauvreté, l'un ressortissant pour l'essentiel au "social collectif", l'autre au "social individualisé". Il s'est ensuite demandé d'où proviennent ceux des conflits qui valorisent démocratiquement le social. Restait à déterminer de quelles façons et jusqu'à quel point la fraternité, la solidarité et la justice, une fois identifiées comme normes sociales, sont érigées en normes juridiques, tout en préservant la part d'idéal qui anime le réel.
La fraternité, la solidarité et la justice, en tant que fondements du "social", ont à coexister avec les normes que la société elle-même produit. Or on sait désormais que les conflits, porteurs de violence contribuent également à vitaliser le social, tout en servant de ferment et de garant à la démocratie. Antinomie inéluctable ou possible complémentarité ? Pour sorti de ce dilemme, l'auteur commence par suivre à la trace le concept de social et par relater le déroulement du grand débat, plein d'enseignements, qui eut lieu à ce sujet de 1881 et 1910. Ce qui lui permet de mettre en évidence les oppositions qui, sous cet angle, divisent de nos jours encore les divers courants de pensée et d'action. Etant donné la dissémination du social, il a dû se limiter à l'analyse de quelques-unes de ses composantes. Ont été choisis, en priorité, le syndicalisme et l'extrême pauvreté, l'un ressortissant pour l'essentiel au "social collectif", l'autre au "social individualisé". Il s'est ensuite demandé d'où proviennent ceux des conflits qui valorisent démocratiquement le social. Restait à déterminer de quelles façons et jusqu'à quel point la fraternité, la solidarité et la justice, une fois identifiées comme normes sociales, sont érigées en normes juridiques, tout en préservant la part d'idéal qui anime le réel.