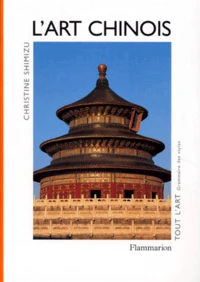Dans le patrimoine du japon, les objets du thé sont parmi les biens culturels les plus précieux. Ils sont transmis avec vénération d'une génération à la suivante. Les métiers artisanaux qui s'y rattachent, gardiens d'un savoir-faire ancestral et source d'une activité économique importante, s'honorent d'être représentés parmi les trésors nationaux vivants.
La consommation du thé, boisson frugale propice à l'éveil et à la méditation, introduite de Chine au Japon, se répandit rapidement à partir du XIVe siècle dans les monastères bouddhiques d'obédience zen et dans les milieux militaires, shôgun et seigneurs féodaux.
Elle fut associée dès le XVe siècle à des séances de recueillement et de conversation codifiées par les maîtres du thé, et portées à leur perfection par les grands maîtres du siècle suivant.
Les objets d'origine chinoise dont l'usage était privilégié dans la cérémonie du thé furent alors remplacés par une production japonaise plus conforme à l'esprit du zen.
Les chefs-d'œuvre de céramique japonaise traduisent cette esthétique nouvelle imprégnée de l'amour de la nature, de sa rusticité, marquée par une volonté de sobriété et dont l'expression très élaborée suggère l'imperfection et l'oeuvre du temps qui passe.
Les pavillons de thé, apparus au XVe siècle, ont été conçus comme des lieux propices à la méditation, soustraits à la vie quotidienne. Ils traduisent une aspiration que les contraintes de la civilisation contemporaine ne fait qu'amplifier.
De nos jours la cérémonie du thé, enseignée dans les cycles parascolaires de la maternelle à l'université, compte au Japon environ cinq millions de participants. Elle est une expression majeure de la culture japonaise.
Dans le patrimoine du japon, les objets du thé sont parmi les biens culturels les plus précieux. Ils sont transmis avec vénération d'une génération à la suivante. Les métiers artisanaux qui s'y rattachent, gardiens d'un savoir-faire ancestral et source d'une activité économique importante, s'honorent d'être représentés parmi les trésors nationaux vivants.
La consommation du thé, boisson frugale propice à l'éveil et à la méditation, introduite de Chine au Japon, se répandit rapidement à partir du XIVe siècle dans les monastères bouddhiques d'obédience zen et dans les milieux militaires, shôgun et seigneurs féodaux.
Elle fut associée dès le XVe siècle à des séances de recueillement et de conversation codifiées par les maîtres du thé, et portées à leur perfection par les grands maîtres du siècle suivant.
Les objets d'origine chinoise dont l'usage était privilégié dans la cérémonie du thé furent alors remplacés par une production japonaise plus conforme à l'esprit du zen.
Les chefs-d'œuvre de céramique japonaise traduisent cette esthétique nouvelle imprégnée de l'amour de la nature, de sa rusticité, marquée par une volonté de sobriété et dont l'expression très élaborée suggère l'imperfection et l'oeuvre du temps qui passe.
Les pavillons de thé, apparus au XVe siècle, ont été conçus comme des lieux propices à la méditation, soustraits à la vie quotidienne. Ils traduisent une aspiration que les contraintes de la civilisation contemporaine ne fait qu'amplifier.
De nos jours la cérémonie du thé, enseignée dans les cycles parascolaires de la maternelle à l'université, compte au Japon environ cinq millions de participants. Elle est une expression majeure de la culture japonaise.