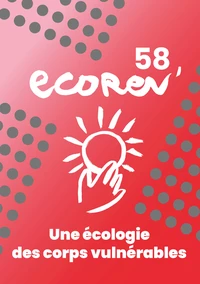Les figures sociales définies par la convergence entre un haut niveau de culture et un sort économique incertain et défavorable suscitent depuis longtemps les craintes, ou d'un autre point de vue les espoirs, de révolte. Qu'en est-il dans la France du début du 21e siècle ? Cette convergence définit-t-elle un groupe social à proprement parler ? Et si oui, quel serait son rapport à la sociologie et à la critique sociale ? Ces questions héritent d'une longue histoire.
C'est pourquoi ce livre commence par retracer les transformations, depuis l'Ancien Régime, des figures visant les instruits en surnombre, comme par exemple le "prolétariat intellectue" vers 1900. Il objective ensuite statistiquement la croissance, au cours des dernières décennies, de l'aire sociale que l'on peut qualifier de précariat culturel, définie par la conjonction entre les situations d'emploi précaires et une activité principale vouée à la culture ou au savoir.
Dans la période récente, comme par le passé, cet objet social très indéterminé suscite un foisonnement d'interprétations, formulées par des essayistes (dont les plus célèbres sont A. et M. Rambach, conceptrices des "intellos précaires") ou des universitaires, voire portées par des mouvements sociaux. A partir d'une enquête par entretiens, le livre présente les contrastes de niveaux d'intégration professionnelle et de formes d'emploi qui divisent le précariat culturel.
Il donne ensuite la parole à ses interviewés, qui déploient leurs parcours et décrivent leurs situations à la lumière des propositions d'identité collective qui prétendent les décrire, se ralliant à la cause des "précaires", mais s'en démarquant aussi, préférant souvent mettre en avant leur libre engagement dans des métiers créatifs que les conditions ingrates qui peuvent leur être imposées. On comprend mieux alors ce qu'est le précariat culturel.
Evoqué le plus souvent dans une intention critique, mais peinant à trouver une formulation politique cohérente, ni pure illusion, ni groupe institué, suspendu entre fictions politiques et réalités sociales : c'est un spectre.
Les figures sociales définies par la convergence entre un haut niveau de culture et un sort économique incertain et défavorable suscitent depuis longtemps les craintes, ou d'un autre point de vue les espoirs, de révolte. Qu'en est-il dans la France du début du 21e siècle ? Cette convergence définit-t-elle un groupe social à proprement parler ? Et si oui, quel serait son rapport à la sociologie et à la critique sociale ? Ces questions héritent d'une longue histoire.
C'est pourquoi ce livre commence par retracer les transformations, depuis l'Ancien Régime, des figures visant les instruits en surnombre, comme par exemple le "prolétariat intellectue" vers 1900. Il objective ensuite statistiquement la croissance, au cours des dernières décennies, de l'aire sociale que l'on peut qualifier de précariat culturel, définie par la conjonction entre les situations d'emploi précaires et une activité principale vouée à la culture ou au savoir.
Dans la période récente, comme par le passé, cet objet social très indéterminé suscite un foisonnement d'interprétations, formulées par des essayistes (dont les plus célèbres sont A. et M. Rambach, conceptrices des "intellos précaires") ou des universitaires, voire portées par des mouvements sociaux. A partir d'une enquête par entretiens, le livre présente les contrastes de niveaux d'intégration professionnelle et de formes d'emploi qui divisent le précariat culturel.
Il donne ensuite la parole à ses interviewés, qui déploient leurs parcours et décrivent leurs situations à la lumière des propositions d'identité collective qui prétendent les décrire, se ralliant à la cause des "précaires", mais s'en démarquant aussi, préférant souvent mettre en avant leur libre engagement dans des métiers créatifs que les conditions ingrates qui peuvent leur être imposées. On comprend mieux alors ce qu'est le précariat culturel.
Evoqué le plus souvent dans une intention critique, mais peinant à trouver une formulation politique cohérente, ni pure illusion, ni groupe institué, suspendu entre fictions politiques et réalités sociales : c'est un spectre.