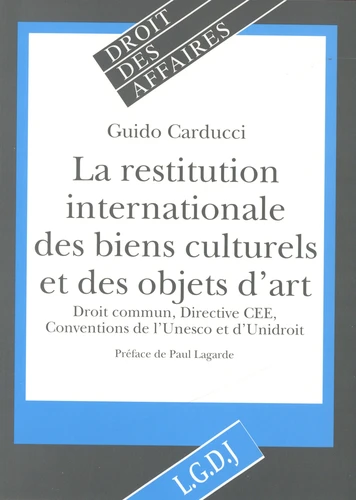La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés. Droit commun, directive CEE, conventions de l'Unesco et d'Unidroit
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages493
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.725 kg
- Dimensions16,0 cm × 22,0 cm × 3,0 cm
- ISBN2-275-01571-X
- EAN9782275015712
- Date de parution19/07/1997
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierPaul Lagarde
Résumé
Le trafic illicite de l'art ne cesse de se développer. Rien qu'en Europe, environ 60 000 objets d'art et biens culturels sont volés chaque année. Face à un tel constat, le législateur, tant au plan communautaire qu'international, ne pouvait rester indifférent : une directive sur la restitution a été adoptée en 1993, désormais transposée en droit français par la loi du 3 août 1995, et la volonté de la communauté internationale de lutter contre le trafic illicite a été affirmée d'abord par la convention pionnière en la matière, celle de l'Unesco de 1970, ratifiée par quatre-vingt-six Etats dont la France en 1997, puis par un instrument centré bien plus spécifiquement sur la restitution internationale, la convention d'Unidroit de 1995, signée par vingt-deux Etats, dont la France.
La possibilité de ratification par celle-ci est actuellement à l'étude. Cet ouvrage vise à permettre un accès plus aisé à la restitution internationale, telle qu'elle résulte de la directive et des deux conventions, ainsi que du droit commun applicable à la portion du contentieux qui n'est pas, ou pas encore, couverte par ces instruments.
La possibilité de ratification par celle-ci est actuellement à l'étude. Cet ouvrage vise à permettre un accès plus aisé à la restitution internationale, telle qu'elle résulte de la directive et des deux conventions, ainsi que du droit commun applicable à la portion du contentieux qui n'est pas, ou pas encore, couverte par ces instruments.
Le trafic illicite de l'art ne cesse de se développer. Rien qu'en Europe, environ 60 000 objets d'art et biens culturels sont volés chaque année. Face à un tel constat, le législateur, tant au plan communautaire qu'international, ne pouvait rester indifférent : une directive sur la restitution a été adoptée en 1993, désormais transposée en droit français par la loi du 3 août 1995, et la volonté de la communauté internationale de lutter contre le trafic illicite a été affirmée d'abord par la convention pionnière en la matière, celle de l'Unesco de 1970, ratifiée par quatre-vingt-six Etats dont la France en 1997, puis par un instrument centré bien plus spécifiquement sur la restitution internationale, la convention d'Unidroit de 1995, signée par vingt-deux Etats, dont la France.
La possibilité de ratification par celle-ci est actuellement à l'étude. Cet ouvrage vise à permettre un accès plus aisé à la restitution internationale, telle qu'elle résulte de la directive et des deux conventions, ainsi que du droit commun applicable à la portion du contentieux qui n'est pas, ou pas encore, couverte par ces instruments.
La possibilité de ratification par celle-ci est actuellement à l'étude. Cet ouvrage vise à permettre un accès plus aisé à la restitution internationale, telle qu'elle résulte de la directive et des deux conventions, ainsi que du droit commun applicable à la portion du contentieux qui n'est pas, ou pas encore, couverte par ces instruments.