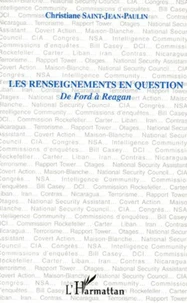La contre-culture aux Etats-Unis dépasse largement, dans les années 60, le phénomène de mode, car elle ébranle les fondements mêmes de la société américaine à peine remise de sa " chasse aux sorcières ". Par peace symbols ou cheveux longs interposés, les hippies et les contestataires traduisent l'exaspération de la génération privilégiée des baby-boomers face à une société " bourgeoise " qui, à leurs yeux, s'enlise dans ses contradictions. Mais quelles conditions ont légitimé et provoqué cette impulsion créative : la fin de la ségrégation, la prise de conscience collective de la pauvreté, la guerre du Vietnam... ? Est-ce suffisant pour analyser un éphémère aussi foisonnant ?
Sans toit ni loi, cette révolution (contre-) culturelle revendique l'utopie et la fête. A San Francisco, Haight-Ashbury est consacré quartier de rêve : parades exubérantes, carnavals hauts en couleur défilent sur fond de musique et de sexe. Certes, la contraception révolutionne les mœurs ! Certes, le féminisme et l'homosexualité bénéficient d'un essor sans précédent ! Certes, la drogue ouvre toutes grandes les Portes de la Perception d'Huxley et explore l'inconscient psychédélique de Leary, Watts ou Ginsberg. Mais, alors, comment expliquer que les jeunes désertent les crash-pads surpeuplés pour fonder de nouvelles tribus dans les communes rurales ? L'irrésistible appel de Kerouac ? Peut-être, plus simplement, un besoin de spiritualités que leur culture semble incapable de satisfaire...
Aujourd'hui, à l'heure du désenchantement du monde, que reste-t-il de cette " révolution " des années 60 dans nos mœurs ou dans nos rêves ?
La contre-culture aux Etats-Unis dépasse largement, dans les années 60, le phénomène de mode, car elle ébranle les fondements mêmes de la société américaine à peine remise de sa " chasse aux sorcières ". Par peace symbols ou cheveux longs interposés, les hippies et les contestataires traduisent l'exaspération de la génération privilégiée des baby-boomers face à une société " bourgeoise " qui, à leurs yeux, s'enlise dans ses contradictions. Mais quelles conditions ont légitimé et provoqué cette impulsion créative : la fin de la ségrégation, la prise de conscience collective de la pauvreté, la guerre du Vietnam... ? Est-ce suffisant pour analyser un éphémère aussi foisonnant ?
Sans toit ni loi, cette révolution (contre-) culturelle revendique l'utopie et la fête. A San Francisco, Haight-Ashbury est consacré quartier de rêve : parades exubérantes, carnavals hauts en couleur défilent sur fond de musique et de sexe. Certes, la contraception révolutionne les mœurs ! Certes, le féminisme et l'homosexualité bénéficient d'un essor sans précédent ! Certes, la drogue ouvre toutes grandes les Portes de la Perception d'Huxley et explore l'inconscient psychédélique de Leary, Watts ou Ginsberg. Mais, alors, comment expliquer que les jeunes désertent les crash-pads surpeuplés pour fonder de nouvelles tribus dans les communes rurales ? L'irrésistible appel de Kerouac ? Peut-être, plus simplement, un besoin de spiritualités que leur culture semble incapable de satisfaire...
Aujourd'hui, à l'heure du désenchantement du monde, que reste-t-il de cette " révolution " des années 60 dans nos mœurs ou dans nos rêves ?