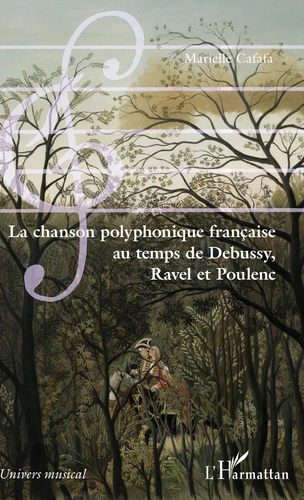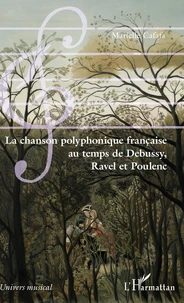La chanson polyphonique française au temps de Debussy, Ravel et Poulenc
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages484
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.716 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,6 cm
- ISBN978-2-343-13603-5
- EAN9782343136035
- Date de parution01/11/2017
- CollectionUnivers musical
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
La chanson polyphonique française pour voix mixtes a cappella connaît un nouvel âge d'or durant la première moitié du XXe siècle comme en témoignent les oeuvres de Raymond Bonheur, Darius Milhaud, Paul Ladmirault, Jean Langlais, Angèle Ravizé et bien d'autres. Ecrites dans un style à la fois moderne et archaïsant, ces chansons, qui peuvent furtivement faire penser aux chansons de la Renaissance, contiennent de multiples références (allusions, citations) à des oeuvres ou à des styles d'écriture apparus entre le Moyen Age et le début du XXe siècle.
Excepté celles de Debussy, Ravel et Poulenc, ces polyphonies françaises sont, pour la plupart, relativement méconnues à l'heure actuelle. Dans cet ouvrage, qui tente de répondre à des questions que l'interprète peut se poser, la réflexion s'appuie sur des partitions, des écrits de compositeurs, des critiques et des enregistrements. Le sujet abordé est susceptible d'intéresser aussi bien des littéraires, des musicologues, des mélomanes que des musiciens.
L'auteur, musicienne, tente ici de déceler les probables sources d'inspiration des compositeurs qu'elle envisage comme des pistes pour penser l'interprétation de l'un des fleurons de la musique française.
Excepté celles de Debussy, Ravel et Poulenc, ces polyphonies françaises sont, pour la plupart, relativement méconnues à l'heure actuelle. Dans cet ouvrage, qui tente de répondre à des questions que l'interprète peut se poser, la réflexion s'appuie sur des partitions, des écrits de compositeurs, des critiques et des enregistrements. Le sujet abordé est susceptible d'intéresser aussi bien des littéraires, des musicologues, des mélomanes que des musiciens.
L'auteur, musicienne, tente ici de déceler les probables sources d'inspiration des compositeurs qu'elle envisage comme des pistes pour penser l'interprétation de l'un des fleurons de la musique française.
La chanson polyphonique française pour voix mixtes a cappella connaît un nouvel âge d'or durant la première moitié du XXe siècle comme en témoignent les oeuvres de Raymond Bonheur, Darius Milhaud, Paul Ladmirault, Jean Langlais, Angèle Ravizé et bien d'autres. Ecrites dans un style à la fois moderne et archaïsant, ces chansons, qui peuvent furtivement faire penser aux chansons de la Renaissance, contiennent de multiples références (allusions, citations) à des oeuvres ou à des styles d'écriture apparus entre le Moyen Age et le début du XXe siècle.
Excepté celles de Debussy, Ravel et Poulenc, ces polyphonies françaises sont, pour la plupart, relativement méconnues à l'heure actuelle. Dans cet ouvrage, qui tente de répondre à des questions que l'interprète peut se poser, la réflexion s'appuie sur des partitions, des écrits de compositeurs, des critiques et des enregistrements. Le sujet abordé est susceptible d'intéresser aussi bien des littéraires, des musicologues, des mélomanes que des musiciens.
L'auteur, musicienne, tente ici de déceler les probables sources d'inspiration des compositeurs qu'elle envisage comme des pistes pour penser l'interprétation de l'un des fleurons de la musique française.
Excepté celles de Debussy, Ravel et Poulenc, ces polyphonies françaises sont, pour la plupart, relativement méconnues à l'heure actuelle. Dans cet ouvrage, qui tente de répondre à des questions que l'interprète peut se poser, la réflexion s'appuie sur des partitions, des écrits de compositeurs, des critiques et des enregistrements. Le sujet abordé est susceptible d'intéresser aussi bien des littéraires, des musicologues, des mélomanes que des musiciens.
L'auteur, musicienne, tente ici de déceler les probables sources d'inspiration des compositeurs qu'elle envisage comme des pistes pour penser l'interprétation de l'un des fleurons de la musique française.