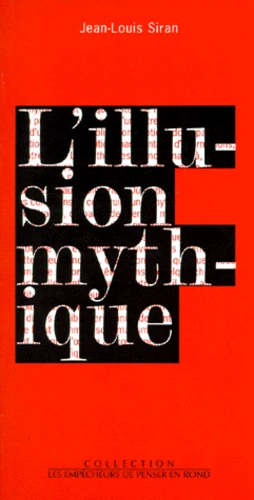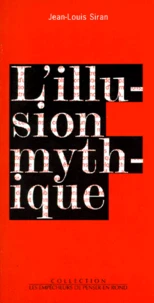L'illusion mythique
Par :Formats :
Disponible d'occasion :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages127
- PrésentationBroché
- Poids0.125 kg
- Dimensions10,5 cm × 20,0 cm × 1,1 cm
- ISBN2-84324-038-7
- EAN9782843240386
- Date de parution04/05/1998
- ÉditeurEmpecheurs de penser en rond
Résumé
Le mythe, c'est ce qui reste une fois que d'un texte, on a prélevé toute trace d'un autre texte. Ombre portée d'une parabole oubliée, on l'obtient donc par soustraction. Ou par addition ; par montage d'informations, d'entretiens. Le mythe n'est donc jamais là, donné, mais toujours fabriqué par le mythographe. Voilà à quoi conduit l'examen des plus grands maîtres en la matière : Griaule, Dieterlen, Dumézil. S'essayer, dans ces conditions, à construire une " mytho-logique " avec Lévi-Strauss, ou parler de " pensée mythique " comme beaucoup d'autres est donc proprement illusoire.
Mais même les esprits les plus critiques à ce sujet, détienne par exemple, n'arrivent pas à renoncer à cette pseudo-notion. C'est donc que quelque chose demande encore à y être pensé, quelque chose qui n'est nullement propre à l'Autre (qu'il soit antique, petit-bourgeois, sauvage ou exotique), mais qui nous habite aussi bien : la narrativité comme mise en forme du divers sensible vers l'unité de l'entendement - ce que Kant nommait le schématisme, et qu'on retrouve tout autant à l'œuvre au cœur même de la recherche la plus scientifique.
Quelques écrits d'Einstein examinés ici sont, à cet effet, éclairants.
Le mythe, c'est ce qui reste une fois que d'un texte, on a prélevé toute trace d'un autre texte. Ombre portée d'une parabole oubliée, on l'obtient donc par soustraction. Ou par addition ; par montage d'informations, d'entretiens. Le mythe n'est donc jamais là, donné, mais toujours fabriqué par le mythographe. Voilà à quoi conduit l'examen des plus grands maîtres en la matière : Griaule, Dieterlen, Dumézil. S'essayer, dans ces conditions, à construire une " mytho-logique " avec Lévi-Strauss, ou parler de " pensée mythique " comme beaucoup d'autres est donc proprement illusoire.
Mais même les esprits les plus critiques à ce sujet, détienne par exemple, n'arrivent pas à renoncer à cette pseudo-notion. C'est donc que quelque chose demande encore à y être pensé, quelque chose qui n'est nullement propre à l'Autre (qu'il soit antique, petit-bourgeois, sauvage ou exotique), mais qui nous habite aussi bien : la narrativité comme mise en forme du divers sensible vers l'unité de l'entendement - ce que Kant nommait le schématisme, et qu'on retrouve tout autant à l'œuvre au cœur même de la recherche la plus scientifique.
Quelques écrits d'Einstein examinés ici sont, à cet effet, éclairants.