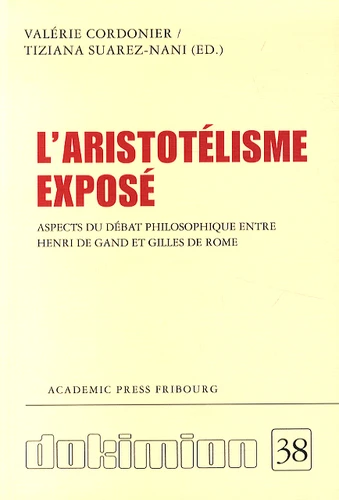L'aristotélisme exposé. Aspects du débat philosophique entre Henri de Gand et Gilles de Rome
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages260
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.505 kg
- Dimensions15,5 cm × 23,0 cm × 1,8 cm
- ISBN978-2-8271-1078-0
- EAN9782827110780
- Date de parution01/05/2014
- CollectionDokimion
- ÉditeurUniversitaires Fribourg Suisse
Résumé
Certains textes ont la particularité de pouvoir être mieux compris en regard d'autres textes : c'est le cas des écrits de Gilles de Rome et d'Henri de Gand, deux théologiens actifs à l'Université de Paris après Thomas d'Aquin (1274). Ces deux auteurs gagnent à être lus en regard l'un de l'autre car c'est ainsi qu'ils ont conduit leurs carrières, écrit leurs travaux et approfondi l'édition des "oeuvres complètes" d'Aristote parue alors.
La méthode commune aux cinq études réunies dans ce livre — de Catherine König-Pralong, Gordon A. Wilson, Pasquale Porro, Valérie Cordonier et Robert Wielockx — consiste à soumettre l'intertexrualité caractéristique de ces écrits à l'analyse, en vue de mieux saisir leur contenu. La lecture croisée des ouvrages d'Henri et de Gilles entre eux, avec ceux de leurs devanciers ou de leurs contemporains ainsi qu'avec des manuscrits de la bibliothèque de Godefroid de Fontaines permet d'approfondir leurs discussions, d'en mettre en lumière des lieux restés jusqu'à présent inaperçus et de mesurer les effets de ce débat sur la réception latine d'Aristote en ce moment où le renouvellement de la philosophie naturelle, de l'anthropologie, de la métaphysique et même de la théologie est passé par une exposition du système aristotélicien — au double sens du terme.
La méthode commune aux cinq études réunies dans ce livre — de Catherine König-Pralong, Gordon A. Wilson, Pasquale Porro, Valérie Cordonier et Robert Wielockx — consiste à soumettre l'intertexrualité caractéristique de ces écrits à l'analyse, en vue de mieux saisir leur contenu. La lecture croisée des ouvrages d'Henri et de Gilles entre eux, avec ceux de leurs devanciers ou de leurs contemporains ainsi qu'avec des manuscrits de la bibliothèque de Godefroid de Fontaines permet d'approfondir leurs discussions, d'en mettre en lumière des lieux restés jusqu'à présent inaperçus et de mesurer les effets de ce débat sur la réception latine d'Aristote en ce moment où le renouvellement de la philosophie naturelle, de l'anthropologie, de la métaphysique et même de la théologie est passé par une exposition du système aristotélicien — au double sens du terme.
Certains textes ont la particularité de pouvoir être mieux compris en regard d'autres textes : c'est le cas des écrits de Gilles de Rome et d'Henri de Gand, deux théologiens actifs à l'Université de Paris après Thomas d'Aquin (1274). Ces deux auteurs gagnent à être lus en regard l'un de l'autre car c'est ainsi qu'ils ont conduit leurs carrières, écrit leurs travaux et approfondi l'édition des "oeuvres complètes" d'Aristote parue alors.
La méthode commune aux cinq études réunies dans ce livre — de Catherine König-Pralong, Gordon A. Wilson, Pasquale Porro, Valérie Cordonier et Robert Wielockx — consiste à soumettre l'intertexrualité caractéristique de ces écrits à l'analyse, en vue de mieux saisir leur contenu. La lecture croisée des ouvrages d'Henri et de Gilles entre eux, avec ceux de leurs devanciers ou de leurs contemporains ainsi qu'avec des manuscrits de la bibliothèque de Godefroid de Fontaines permet d'approfondir leurs discussions, d'en mettre en lumière des lieux restés jusqu'à présent inaperçus et de mesurer les effets de ce débat sur la réception latine d'Aristote en ce moment où le renouvellement de la philosophie naturelle, de l'anthropologie, de la métaphysique et même de la théologie est passé par une exposition du système aristotélicien — au double sens du terme.
La méthode commune aux cinq études réunies dans ce livre — de Catherine König-Pralong, Gordon A. Wilson, Pasquale Porro, Valérie Cordonier et Robert Wielockx — consiste à soumettre l'intertexrualité caractéristique de ces écrits à l'analyse, en vue de mieux saisir leur contenu. La lecture croisée des ouvrages d'Henri et de Gilles entre eux, avec ceux de leurs devanciers ou de leurs contemporains ainsi qu'avec des manuscrits de la bibliothèque de Godefroid de Fontaines permet d'approfondir leurs discussions, d'en mettre en lumière des lieux restés jusqu'à présent inaperçus et de mesurer les effets de ce débat sur la réception latine d'Aristote en ce moment où le renouvellement de la philosophie naturelle, de l'anthropologie, de la métaphysique et même de la théologie est passé par une exposition du système aristotélicien — au double sens du terme.