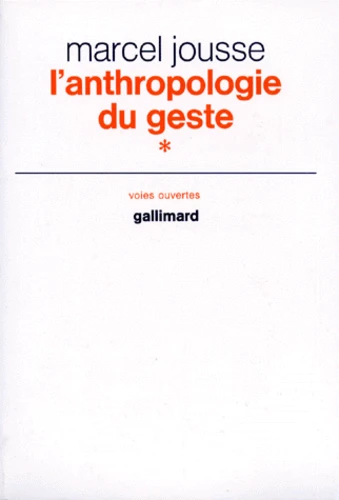L'Anthropologie du geste. Tome 1
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages410
- PrésentationBroché
- Poids0.405 kg
- Dimensions14,0 cm × 20,5 cm × 2,8 cm
- ISBN2-07-029126-X
- EAN9782070291267
- Date de parution01/12/1974
- Collectionvoies ouvertes
- ÉditeurGallimard
Résumé
L'auteur de " L'Anthropologie du Geste " met en question l'hégémonie d'une civilisation de style écrit qui tend à s'imposer comme la civilisation unique. Pour lui, le livresque masque les abîmes souterrains de l'homme où se révèle ce qu'il y a de plus humain. Ainsi s'acharne-t-il à dénoncer les scléroses conceptuelles qui résistent au jaillissement de la vie.
Chaque être humain reçoit la pression que le cosmos exerce sur lui, non seulement la reçoit mais l'assimile et la mime spontanément selon un rythme unique qui est le sien. Ces pages qui seront une révélation pour beaucoup sont une leçon de réalisme.
Si Marcel Jousse est traditionnel en ce qu'il croit à la nécessité d'un sol où s'enracine le langage, et se situe ainsi aux antipodes d'un Bultmann ou d'un Levinas, il est révolutionnaire en ce sens qu'il prend le parti de l'oralité. Malgré certaines apparences, la parole, partout dans le monde, est réprimée, souvent écrasée. En rendant manifestes les sources concrètes de la connaissance, Jousse fait œuvre de libération.
Pour lui, les mécanismes du grand fonds commun anthropologique trouvent leur expression parfaite dans les Evangiles. On peut en discuter. C'est un aspect secondaire aujourd'hui. Jousse n'est pas un apologète mais avant tout un homme de science. Son œuvre, profondément originale et qui bouscule les catégories, s'irradie dans toutes les directions et apporte un nouvel éclairage en de nombreux domaines.
Jusqu'en 1957, Marcel Jousse a enseigné en Sorbonne, à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, à l'Ecole d'anthropologie. Ses premiers travaux passèrent pour insolites. Or aujourd'hui, ils s'inscrivent parfaitement dans le courant de la linguistique et de l'anthropologie culturelle. Le vocabulaire qu'en précurseur il se forgea lui-même ne saurait heurter à notre époque. Il n'écrivit guère, étant lui-même un " oral ". Mais ses cours, pris en sténotypie par ses élèves, forment une œuvre considérable.
L'auteur de " L'Anthropologie du Geste " met en question l'hégémonie d'une civilisation de style écrit qui tend à s'imposer comme la civilisation unique. Pour lui, le livresque masque les abîmes souterrains de l'homme où se révèle ce qu'il y a de plus humain. Ainsi s'acharne-t-il à dénoncer les scléroses conceptuelles qui résistent au jaillissement de la vie.
Chaque être humain reçoit la pression que le cosmos exerce sur lui, non seulement la reçoit mais l'assimile et la mime spontanément selon un rythme unique qui est le sien. Ces pages qui seront une révélation pour beaucoup sont une leçon de réalisme.
Si Marcel Jousse est traditionnel en ce qu'il croit à la nécessité d'un sol où s'enracine le langage, et se situe ainsi aux antipodes d'un Bultmann ou d'un Levinas, il est révolutionnaire en ce sens qu'il prend le parti de l'oralité. Malgré certaines apparences, la parole, partout dans le monde, est réprimée, souvent écrasée. En rendant manifestes les sources concrètes de la connaissance, Jousse fait œuvre de libération.
Pour lui, les mécanismes du grand fonds commun anthropologique trouvent leur expression parfaite dans les Evangiles. On peut en discuter. C'est un aspect secondaire aujourd'hui. Jousse n'est pas un apologète mais avant tout un homme de science. Son œuvre, profondément originale et qui bouscule les catégories, s'irradie dans toutes les directions et apporte un nouvel éclairage en de nombreux domaines.
Jusqu'en 1957, Marcel Jousse a enseigné en Sorbonne, à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, à l'Ecole d'anthropologie. Ses premiers travaux passèrent pour insolites. Or aujourd'hui, ils s'inscrivent parfaitement dans le courant de la linguistique et de l'anthropologie culturelle. Le vocabulaire qu'en précurseur il se forgea lui-même ne saurait heurter à notre époque. Il n'écrivit guère, étant lui-même un " oral ". Mais ses cours, pris en sténotypie par ses élèves, forment une œuvre considérable.