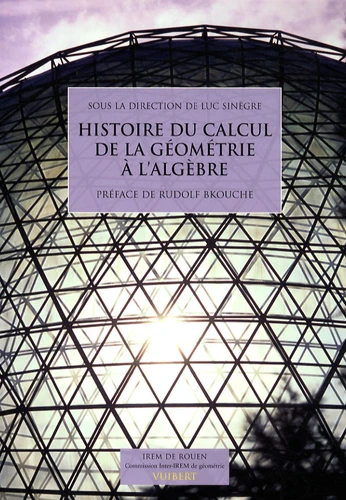Histoire du calcul de la géométrie à l'algèbre
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages289
- PrésentationBroché
- Poids0.53 kg
- Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 1,3 cm
- ISBN978-2-7117-2226-6
- EAN9782711722266
- Date de parution15/07/2009
- ÉditeurVuibert
- PréfacierRudolf Bkouche
Résumé
Dans ce livre d'histoire, on découvrira en quoi le calcul sert non seulement à mesurer les choses, mais à les penser. Dans l'Antiquité, on avait besoin de mesurer et d'arpenter. Les problèmes que se sont posés les Egyptiens ressemblent d'ailleurs à ceux que l'on étudiait encore à l'école primaire avant la réforme des mathématiques modernes La si célèbre règle de trois en fait partie (Première partie de l'ouvrage). Quand les problèmes se compliquent, mieux vaut introduire des lettres. On aboutit alors au langage algébrique (qui peut, lui aussi, rester un mauvais souvenir de classe !), Les problèmes vont alors s'écrire alphabétiquement (chaque mathématicien avait autrefois son propre système) et devenir des équations. C'est ainsi que Descartes voulut mettre le monde en équations. Au XVIIe siècle et presque par hasard, le calcul va se mettre au service de la géométrie qui deviendra, avec Newton et Leibniz, la géométrie analytique. Côté histoire, on verra que de nombreux mathématiciens rencontrés au fil de ces pages se sont croisés, sous Louis XIII, au siège de La Rochelle ! (partie II). Comment menait-on un calcul avant l'usage des calculatrices ? Si l'emploi des règles à calcul et des tables de logarithmes est bien connu, sait-on que les artilleurs de la première Guerre mondiale avaient en poche un abaque pour ajuster leurs tirs ? L'efficacité de ces abaques reposait pourtant sur une géométrie issue de la perspective qui, au départ, oppose le trait au calcul (partie III). A partir du XIXe siècle il faudra bien rassembler et ordonner toutes ces tentatives. Les règles de calcul vont devenir elles-mêmes des objets de pensée qu'on va appeler des structures. La dernière partie du livre fournit plusieurs exemples de ce processus.
Dans ce livre d'histoire, on découvrira en quoi le calcul sert non seulement à mesurer les choses, mais à les penser. Dans l'Antiquité, on avait besoin de mesurer et d'arpenter. Les problèmes que se sont posés les Egyptiens ressemblent d'ailleurs à ceux que l'on étudiait encore à l'école primaire avant la réforme des mathématiques modernes La si célèbre règle de trois en fait partie (Première partie de l'ouvrage). Quand les problèmes se compliquent, mieux vaut introduire des lettres. On aboutit alors au langage algébrique (qui peut, lui aussi, rester un mauvais souvenir de classe !), Les problèmes vont alors s'écrire alphabétiquement (chaque mathématicien avait autrefois son propre système) et devenir des équations. C'est ainsi que Descartes voulut mettre le monde en équations. Au XVIIe siècle et presque par hasard, le calcul va se mettre au service de la géométrie qui deviendra, avec Newton et Leibniz, la géométrie analytique. Côté histoire, on verra que de nombreux mathématiciens rencontrés au fil de ces pages se sont croisés, sous Louis XIII, au siège de La Rochelle ! (partie II). Comment menait-on un calcul avant l'usage des calculatrices ? Si l'emploi des règles à calcul et des tables de logarithmes est bien connu, sait-on que les artilleurs de la première Guerre mondiale avaient en poche un abaque pour ajuster leurs tirs ? L'efficacité de ces abaques reposait pourtant sur une géométrie issue de la perspective qui, au départ, oppose le trait au calcul (partie III). A partir du XIXe siècle il faudra bien rassembler et ordonner toutes ces tentatives. Les règles de calcul vont devenir elles-mêmes des objets de pensée qu'on va appeler des structures. La dernière partie du livre fournit plusieurs exemples de ce processus.