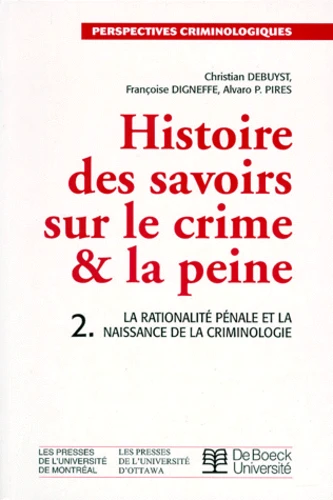Histoire des savoirs sur le crime et la peine. Tome 2, La rationalité pénale et la naissance de la criminologie
Par : , ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages518
- PrésentationBroché
- Poids0.845 kg
- Dimensions16,2 cm × 24,0 cm × 2,9 cm
- ISBN2-8041-1967-X
- EAN9782804119676
- Date de parution08/09/1998
- Collectionperspectives criminologiques
- ÉditeurDe Boeck
Résumé
Ce deuxième volume présente la formation de la rationalité pénale moderne, ses effectifs sur la naissance de la criminologie et sur les débats à propos de la question criminelle au tournant du siècle.
Peut-on dire que la croyance en la sévérité des peines du début du XVIIIe siècle ait disparu ?
Comment la volonté d'adopter une perspective scientifique sur la question criminelle a-t-elle affecté les enjeux de ce débat, notamment au niveau des recherches psychiatriques qui mettent en évidence des notions comme celles de dégénérescence ou d'eugénisme ?
En quoi les analyses sociologiques de penseurs comme Tarde et Durkheim ont-elles ouvert de nouveaux horizons à propos des savoirs sur le crime et la peine jusqu'aux années 1920 en Europe et en Amérique du Nord ?
Cet ouvrage est la suite logique et chronologique du volume 1 : Des savoirs diffus à la notion du criminel-né.
Ce deuxième volume présente la formation de la rationalité pénale moderne, ses effectifs sur la naissance de la criminologie et sur les débats à propos de la question criminelle au tournant du siècle.
Peut-on dire que la croyance en la sévérité des peines du début du XVIIIe siècle ait disparu ?
Comment la volonté d'adopter une perspective scientifique sur la question criminelle a-t-elle affecté les enjeux de ce débat, notamment au niveau des recherches psychiatriques qui mettent en évidence des notions comme celles de dégénérescence ou d'eugénisme ?
En quoi les analyses sociologiques de penseurs comme Tarde et Durkheim ont-elles ouvert de nouveaux horizons à propos des savoirs sur le crime et la peine jusqu'aux années 1920 en Europe et en Amérique du Nord ?
Cet ouvrage est la suite logique et chronologique du volume 1 : Des savoirs diffus à la notion du criminel-né.