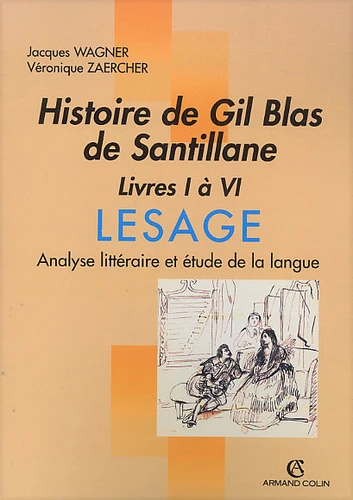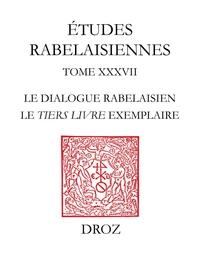Histoire De Gil Blas De Santillane De Lesage. Livre I A Vi
Par : ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages149
- PrésentationBroché
- Poids0.22 kg
- Dimensions15,0 cm × 21,0 cm × 1,5 cm
- ISBN2-200-26396-1
- EAN9782200263966
- Date de parution05/11/2002
- ÉditeurArmand Colin
Résumé
En réponse aux critiques dont Gil Blas a été l'objet, on a montré, dés 1956, ses qualités de disposition (roman construit malgré une allure désarticulée), d'invention (roman de formation et d'ascension sociale) et d'élocution (virtuosité narrative, allégresse spirituelle et vivacité parodique).
Réintégré dans la sphère artistique, Lesage n'a pourtant pas acquis la stature des Challe, Marivaux ou Crébillon, malgré sa dénonciation, nourrie d'augustinisme cartésianisé, de toutes les poses esthétiques et morales égarant esprit et cœur et des artifices d'une poétique flatteuse. Ce roman ne dirait-il pas, lui aussi, la scission d'une conscience partagée entre un ancien idéal pastoral (Fénelon) et le réel inassimilable (tragique) de la mort ou dégradant (comique) de l'amour-propre ?
L'étude de la langue des livres I à III met l'accent sur la survivance des traits classiques dans la langue de Lesage, particulièrement au plan syntaxique, sur les problèmes linguistiques de la narration (points de vue, modalisations, temporalité) et sur les faits lexicaux, grammaticaux et stylistiques, relatifs à la figuration du monde.
En réponse aux critiques dont Gil Blas a été l'objet, on a montré, dés 1956, ses qualités de disposition (roman construit malgré une allure désarticulée), d'invention (roman de formation et d'ascension sociale) et d'élocution (virtuosité narrative, allégresse spirituelle et vivacité parodique).
Réintégré dans la sphère artistique, Lesage n'a pourtant pas acquis la stature des Challe, Marivaux ou Crébillon, malgré sa dénonciation, nourrie d'augustinisme cartésianisé, de toutes les poses esthétiques et morales égarant esprit et cœur et des artifices d'une poétique flatteuse. Ce roman ne dirait-il pas, lui aussi, la scission d'une conscience partagée entre un ancien idéal pastoral (Fénelon) et le réel inassimilable (tragique) de la mort ou dégradant (comique) de l'amour-propre ?
L'étude de la langue des livres I à III met l'accent sur la survivance des traits classiques dans la langue de Lesage, particulièrement au plan syntaxique, sur les problèmes linguistiques de la narration (points de vue, modalisations, temporalité) et sur les faits lexicaux, grammaticaux et stylistiques, relatifs à la figuration du monde.