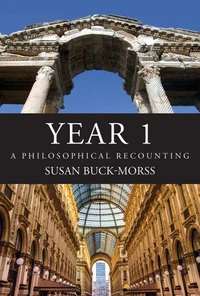Cet essai, bref, incisif et savant, s'étonne de la coexistence paradoxale, au XVIIIe siècle, des idéaux d'égalité des lumières et de la pratique de l'esclavage, laquelle connaît alors son effarant apogée. On sait ce qu'il en a été des penseurs français ; Louis Sala-Molins l'a établi avec force. Mais qu'en fut-il des penseurs allemands ? Et de Hegel, le tout premier ? Peut-on imaginer que celui-ci élabora sa dialectique du maître et de l'esclave dans l'ignorance de l'existence de l'esclavage en tant que tel, et du soulèvement emblématique, mené par Toussaint Louverture, et couronné de succès, des esclaves de Saint-Domingue ? C'est ce qu'on imagine en effet.
Mais pas Susan Buck-Morss qui, dans Hegel et Haïti, avance au contraire l'hypothèse suivant laquelle c'est e inspirant sciemment de la réalité haïtienne que Hegel a réussi à déplacer le discours philosophique abstrait vers une opposition dialectique concrète. Il ne s'agit certes pas de nier qu'il reviendra plus tard vers un conservatisme de nature à justifier nombre de théories eurocentristes ultérieures ; seulement d'affirmer que Hegel a connu un moment de lucidité déterminant dont il importe de mesurer la portée dans l'élaboration d'un projet de liberté universelle.
Cet essai, bref, incisif et savant, s'étonne de la coexistence paradoxale, au XVIIIe siècle, des idéaux d'égalité des lumières et de la pratique de l'esclavage, laquelle connaît alors son effarant apogée. On sait ce qu'il en a été des penseurs français ; Louis Sala-Molins l'a établi avec force. Mais qu'en fut-il des penseurs allemands ? Et de Hegel, le tout premier ? Peut-on imaginer que celui-ci élabora sa dialectique du maître et de l'esclave dans l'ignorance de l'existence de l'esclavage en tant que tel, et du soulèvement emblématique, mené par Toussaint Louverture, et couronné de succès, des esclaves de Saint-Domingue ? C'est ce qu'on imagine en effet.
Mais pas Susan Buck-Morss qui, dans Hegel et Haïti, avance au contraire l'hypothèse suivant laquelle c'est e inspirant sciemment de la réalité haïtienne que Hegel a réussi à déplacer le discours philosophique abstrait vers une opposition dialectique concrète. Il ne s'agit certes pas de nier qu'il reviendra plus tard vers un conservatisme de nature à justifier nombre de théories eurocentristes ultérieures ; seulement d'affirmer que Hegel a connu un moment de lucidité déterminant dont il importe de mesurer la portée dans l'élaboration d'un projet de liberté universelle.