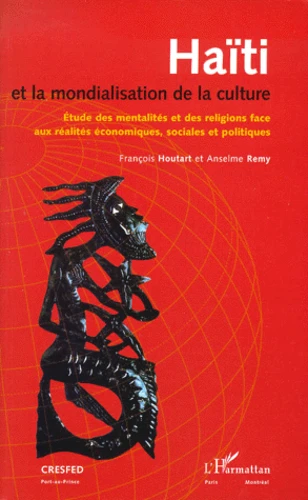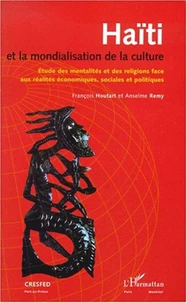HAITI ET LA MONDIALISATION DE LA CULTURE.. Etude des mentalités et des religions face aux réalités économiques, sociales et politiques
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages210
- PrésentationBroché
- Poids0.285 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,6 cm × 1,4 cm
- ISBN2-7384-8883-8
- EAN9782738488831
- Date de parution07/03/2000
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Le dilemme de l'identité et de la mondialisation culturelle se pose en Haïti, comme dans l'ensemble du monde. L'enjeu est constitué par les conditions sociales de la mondialisation culturelle qui est véhiculée par l'économie dominante à l'échelle de la planète. La culture se situe au centre d'une dynamique sociale, construite au cours du temps, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à l'histoire contemporaine. Elle est marquée par l'héritage africain qui s'exprime dans le vaudou et par le marronage (les esclaves qui fuyaient dans les montagnes, pour échapper au système dominant) et qui se répercute en tant que résistance dans les champs économiques, sociaux, politiques et culturels. La distinction entre une pensée symbolique et une pensée analytique s'exprime, à la fois dans les représentations des rapports à la nature et dans les rapports sociaux. Les croyances et les expressions religieuses sont au centre de la culture de la région. Les modèles culturels recouvrent les deux modes de pensée cités plus haut, mais on rencontre aussi des modèles de transition et de marginalisation. Une section de l'ouvrage concerne la culture politique. D'où la question de l'apport de chaque culture locale à une culture mondiale, comme alternative à une simple intégration dans une culture mondialisée. Cela implique des changements dans la pensée symbolique, qui est porteuse de valeurs capables d'indiquer d'autres voies à la domination du marché. L'ouvrage se termine par une postface de Gérard Barthémemy, indiquant des pistes pour l'action.
Le dilemme de l'identité et de la mondialisation culturelle se pose en Haïti, comme dans l'ensemble du monde. L'enjeu est constitué par les conditions sociales de la mondialisation culturelle qui est véhiculée par l'économie dominante à l'échelle de la planète. La culture se situe au centre d'une dynamique sociale, construite au cours du temps, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à l'histoire contemporaine. Elle est marquée par l'héritage africain qui s'exprime dans le vaudou et par le marronage (les esclaves qui fuyaient dans les montagnes, pour échapper au système dominant) et qui se répercute en tant que résistance dans les champs économiques, sociaux, politiques et culturels. La distinction entre une pensée symbolique et une pensée analytique s'exprime, à la fois dans les représentations des rapports à la nature et dans les rapports sociaux. Les croyances et les expressions religieuses sont au centre de la culture de la région. Les modèles culturels recouvrent les deux modes de pensée cités plus haut, mais on rencontre aussi des modèles de transition et de marginalisation. Une section de l'ouvrage concerne la culture politique. D'où la question de l'apport de chaque culture locale à une culture mondiale, comme alternative à une simple intégration dans une culture mondialisée. Cela implique des changements dans la pensée symbolique, qui est porteuse de valeurs capables d'indiquer d'autres voies à la domination du marché. L'ouvrage se termine par une postface de Gérard Barthémemy, indiquant des pistes pour l'action.