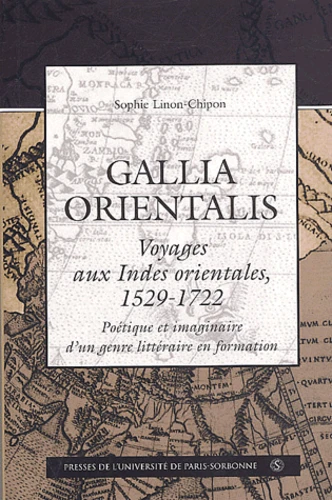Gallia orientalis, voyages aux Indes orientales (1529-1722). Poétique et imaginaire d'un genre littéraire en formation
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages691
- PrésentationBroché
- Poids1.185 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 4,0 cm
- ISBN2-84050-261-5
- EAN9782840502616
- Date de parution01/01/2003
- CollectionImago mundi
- ÉditeurPU Paris-Sorbonne
- PréfacierDirk Van der Cruysse
Résumé
Vers la fin du XVe sicle, le monde occidental assiste à une rupture épistémologique qui va totalement bouleverser sa vision de l'univers connu et reconnu. Et l'Amérique n'est pas seule en cause. L'Orient était, jusqu'alors, aux confins de la route du Levant, il est maintenant au-delà d'une Afrique enfin contournée à la suite de Bartholomeo Diaz qui franchit le cap de Bonne-Espérance en 1488 et ouvre la fameuse Carreira da India. Lorsqu'en 1529, Jean et Raoul Parmentier quittent Dieppe sur les navires le Sacre et la Pensée, affrétés par le puissant amateur Jean Ango, ils sont loin de soupçonner que leur initiative sera suivie par d'autres Français. L'histoire maritime de la France orientale commence avec eux, de part et d'autre de la route des épices. Cette idée prend même une dénomination dans l'artifice d'un toponyme qui englobe cette vaste étendue et que les Français forgent à leur usage : Gallia orientalis. Ils furent donc quelques milliers de marins français à monter à bord des navires de grand tonnage, des flûtes ou quelques houcres pour passer outre la zone torride et les quarantièmes rugissants. Rares, cependant, furent ceux qui laissèrent à la postérité un récit publié de leur voyage. Les aventures de ces voyageurs ont été retracées sous la forme d'un Journal, d'une Histoire, d'une Description, d'une Relation ou de Mémoires qui n'ont pas eu la gloire - ni non plus le mérite - de figurer dans le panthéon littéraire. En marge des grands genres et à la frontière entre l'histoire, la géographie historique et politique, l'ethnologie et, par certains aspects, la littérature, le genre de la relation de voyage n'existe guère. Il fallait réparer cet oubli des pionniers qui ont, non seulement, gardé la mémoire des premières expéditions françaises dans ces contrées, mais qui ont aussi participé de façon non négligeable à l'élaboration du genre de la relation de voyage. Né de la confrontation entre les légendes, les mythes, les rêves et les observations minutieusement menées sur le terrain, le voyage des idées est, à l'évidence, ce qui reste de plus précieux. Au-delà de l'aventure coloniale, marchande, politique ou scientifique, ces hommes souvent ingénus ou diaboliquement entêtés ont rapporté de leur aventure exotique un témoignage vivant et précieux que les lettrés les plus avisés ont lu avec grand intérêt. Ces reporters de l'Âge classique ont, souvent malgré eux, posé des questions fondamentales sur la destinée de l'humanité, la figure du monde et la place de Dieu transformant leur pérégrination en réflexion philosophique et spirituelle. Nous avons retrouvé chez chacun de ces marins souvent peu cultivés, soldats, marchands, gardes de la marine mais aussi gouverneurs, généraux, ambassadeurs, écrivains de navire, savants curieux, missionnaires, abbés, pères jésuites, protestants exilés, le mérite et le courage d'avoir, tous ensemble, cru à cette Gallia orientalis. C'est à l'histoire mouvementée de ces voyageurs, c'est à l'histoire de leurs écrits et de leur pensée naissante que st ouvrage se destine pour cerner les modalités d'émergence d'une esthétique du voyage sur la route maritime des épices sur fond de poétique d'un genre littéraire en formation aux frontières de l'imaginaire.
Vers la fin du XVe sicle, le monde occidental assiste à une rupture épistémologique qui va totalement bouleverser sa vision de l'univers connu et reconnu. Et l'Amérique n'est pas seule en cause. L'Orient était, jusqu'alors, aux confins de la route du Levant, il est maintenant au-delà d'une Afrique enfin contournée à la suite de Bartholomeo Diaz qui franchit le cap de Bonne-Espérance en 1488 et ouvre la fameuse Carreira da India. Lorsqu'en 1529, Jean et Raoul Parmentier quittent Dieppe sur les navires le Sacre et la Pensée, affrétés par le puissant amateur Jean Ango, ils sont loin de soupçonner que leur initiative sera suivie par d'autres Français. L'histoire maritime de la France orientale commence avec eux, de part et d'autre de la route des épices. Cette idée prend même une dénomination dans l'artifice d'un toponyme qui englobe cette vaste étendue et que les Français forgent à leur usage : Gallia orientalis. Ils furent donc quelques milliers de marins français à monter à bord des navires de grand tonnage, des flûtes ou quelques houcres pour passer outre la zone torride et les quarantièmes rugissants. Rares, cependant, furent ceux qui laissèrent à la postérité un récit publié de leur voyage. Les aventures de ces voyageurs ont été retracées sous la forme d'un Journal, d'une Histoire, d'une Description, d'une Relation ou de Mémoires qui n'ont pas eu la gloire - ni non plus le mérite - de figurer dans le panthéon littéraire. En marge des grands genres et à la frontière entre l'histoire, la géographie historique et politique, l'ethnologie et, par certains aspects, la littérature, le genre de la relation de voyage n'existe guère. Il fallait réparer cet oubli des pionniers qui ont, non seulement, gardé la mémoire des premières expéditions françaises dans ces contrées, mais qui ont aussi participé de façon non négligeable à l'élaboration du genre de la relation de voyage. Né de la confrontation entre les légendes, les mythes, les rêves et les observations minutieusement menées sur le terrain, le voyage des idées est, à l'évidence, ce qui reste de plus précieux. Au-delà de l'aventure coloniale, marchande, politique ou scientifique, ces hommes souvent ingénus ou diaboliquement entêtés ont rapporté de leur aventure exotique un témoignage vivant et précieux que les lettrés les plus avisés ont lu avec grand intérêt. Ces reporters de l'Âge classique ont, souvent malgré eux, posé des questions fondamentales sur la destinée de l'humanité, la figure du monde et la place de Dieu transformant leur pérégrination en réflexion philosophique et spirituelle. Nous avons retrouvé chez chacun de ces marins souvent peu cultivés, soldats, marchands, gardes de la marine mais aussi gouverneurs, généraux, ambassadeurs, écrivains de navire, savants curieux, missionnaires, abbés, pères jésuites, protestants exilés, le mérite et le courage d'avoir, tous ensemble, cru à cette Gallia orientalis. C'est à l'histoire mouvementée de ces voyageurs, c'est à l'histoire de leurs écrits et de leur pensée naissante que st ouvrage se destine pour cerner les modalités d'émergence d'une esthétique du voyage sur la route maritime des épices sur fond de poétique d'un genre littéraire en formation aux frontières de l'imaginaire.