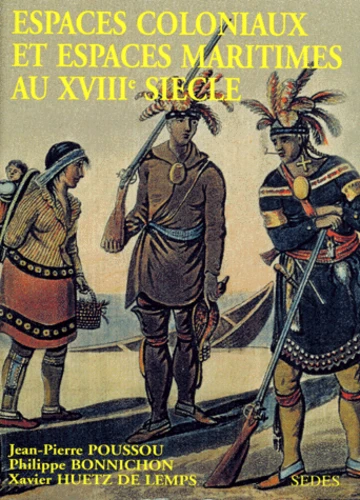ESPACES COLONIAUX ET ESPACES MARITIMES AU XVIIIEME SIECLE.. Les deux Amériques et la Pacifique
Par : , ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages368
- PrésentationBroché
- Poids0.635 kg
- Dimensions17,5 cm × 24,0 cm × 2,1 cm
- ISBN2-7181-9509-6
- EAN9782718195094
- Date de parution03/03/1998
- CollectionRegards sur l'histoire
- ÉditeurSedes
Résumé
A la différence des autres volumes, celui-ci part des espaces coloniaux pour retrouver les espaces maritimes, en insistant sur les interactions qui les lient.
Elles sont tout à fait considérables en Amérique du Nord : même si les Français développent un " empire " continental tout à fait original, la respiration atlantique, qui est évidemment totale pour les îles de la Caraïbe, leur est indispensable, et c'est parce que la France a perdu la maîtrise navale de l'Atlantique Nord qu'elle a dû reculer à plusieurs reprises devant un Royaume-Uni qui disposait d'une remarquable Navy et d'un espace de peuplement colonial continental considérable. Egale pour le commerce antillais, la France était inférieure pour tout le reste.
On retrouve au demeurant la pression anglaise dans l'Atlantique Sud où, malgré leurs très fortes positions, les Ibériques souffrent de leur redoutable concurrence et de leur pénétration économique. Grâce à l'importance de leur empire continental, les Ibériques continuent à tenir leur rôle, et le jeu reste ouvert, à la fin du XVIIIe siècle, dans cet espace américain et océanique où passent la majorité des routes maritimes des échanges mondiaux.
Parmi eux, il faut distinguer ceux du monde du Pacifique resté dominé par l'Espagne. Elle doit néanmoins faire face, surtout après 1763, à la concurrence navale et économique des autres puissances européennes, qu'elle arrive encore à surmonter grâce à son espace colonial aux deux bouts de la route du galion de Manille. Elle n'en a pas moins été obligée de mener de profondes réformes économiques et un effort naval sans précédent.
A la différence des autres volumes, celui-ci part des espaces coloniaux pour retrouver les espaces maritimes, en insistant sur les interactions qui les lient.
Elles sont tout à fait considérables en Amérique du Nord : même si les Français développent un " empire " continental tout à fait original, la respiration atlantique, qui est évidemment totale pour les îles de la Caraïbe, leur est indispensable, et c'est parce que la France a perdu la maîtrise navale de l'Atlantique Nord qu'elle a dû reculer à plusieurs reprises devant un Royaume-Uni qui disposait d'une remarquable Navy et d'un espace de peuplement colonial continental considérable. Egale pour le commerce antillais, la France était inférieure pour tout le reste.
On retrouve au demeurant la pression anglaise dans l'Atlantique Sud où, malgré leurs très fortes positions, les Ibériques souffrent de leur redoutable concurrence et de leur pénétration économique. Grâce à l'importance de leur empire continental, les Ibériques continuent à tenir leur rôle, et le jeu reste ouvert, à la fin du XVIIIe siècle, dans cet espace américain et océanique où passent la majorité des routes maritimes des échanges mondiaux.
Parmi eux, il faut distinguer ceux du monde du Pacifique resté dominé par l'Espagne. Elle doit néanmoins faire face, surtout après 1763, à la concurrence navale et économique des autres puissances européennes, qu'elle arrive encore à surmonter grâce à son espace colonial aux deux bouts de la route du galion de Manille. Elle n'en a pas moins été obligée de mener de profondes réformes économiques et un effort naval sans précédent.