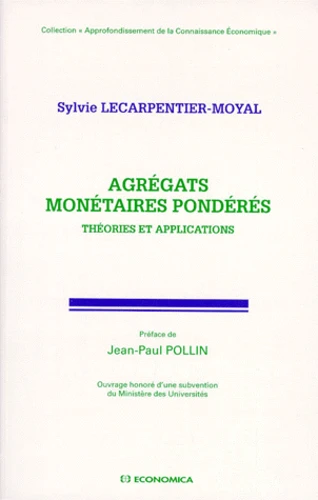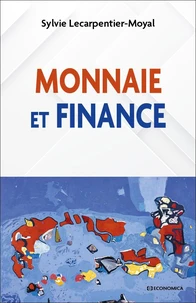Agregats Monataires Ponderes. Theories Et Applications
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages270
- PrésentationBroché
- Poids0.505 kg
- Dimensions15,6 cm × 24,0 cm × 1,9 cm
- ISBN2-7178-3699-3
- EAN9782717836998
- Date de parution14/10/1998
- CollectionApprofondissement de la conna
- ÉditeurEconomica
Résumé
Cet ouvrage s'intéresse à l'opportunité pour les banques centrales d'élaborer des agrégats monétaires pondérés et d'utiliser ces derniers, comme objectifs intermédiaires ou indicateurs, dans le cadre de la politique monétaire. En effet, depuis ces quinze dernières années, la stratégie de "ciblage" des agrégats monétaires officiels s'est avérée un échec, notamment en raison de l'instabilité constatée de la fonction de demande de monnaie (due en partie à la libéralisation du secteur financier). Pour certains économistes, cet échec s'explique par le manque de représentativité des agrégats monétaires pour mesurer ce qu'est la "monnaie". Ces agrégats reposent en effet sur l'hypothèse implicite forte suivant laquelle tous les actifs sont de parfaits substituts les uns des autres. Les agrégats monétaires pondérés relâchent cette hypothèse puisque chaque actif est désormais pondéré par son degré de "monétarité". Diverses formulations de ces agrégats sont proposées, notamment les indices de Divisia qui reposent sur des fondements théoriques rigoureux, et soumises à l'épreuve des faits dans le cas de la France. Les agrégats pondérés dominent les agrégats traditionnels de simple sommation dans la mesure où ils permettent de réduire l'écart entre l'agrégat optimal du point de vue de la demande de monnaie et l'agrégat optimal du point de vue de l'offre de monnaie. Ce résultat montre que la prise en compte d'agrégats pondérés confère plus de cohérence à la politique.
Cet ouvrage s'intéresse à l'opportunité pour les banques centrales d'élaborer des agrégats monétaires pondérés et d'utiliser ces derniers, comme objectifs intermédiaires ou indicateurs, dans le cadre de la politique monétaire. En effet, depuis ces quinze dernières années, la stratégie de "ciblage" des agrégats monétaires officiels s'est avérée un échec, notamment en raison de l'instabilité constatée de la fonction de demande de monnaie (due en partie à la libéralisation du secteur financier). Pour certains économistes, cet échec s'explique par le manque de représentativité des agrégats monétaires pour mesurer ce qu'est la "monnaie". Ces agrégats reposent en effet sur l'hypothèse implicite forte suivant laquelle tous les actifs sont de parfaits substituts les uns des autres. Les agrégats monétaires pondérés relâchent cette hypothèse puisque chaque actif est désormais pondéré par son degré de "monétarité". Diverses formulations de ces agrégats sont proposées, notamment les indices de Divisia qui reposent sur des fondements théoriques rigoureux, et soumises à l'épreuve des faits dans le cas de la France. Les agrégats pondérés dominent les agrégats traditionnels de simple sommation dans la mesure où ils permettent de réduire l'écart entre l'agrégat optimal du point de vue de la demande de monnaie et l'agrégat optimal du point de vue de l'offre de monnaie. Ce résultat montre que la prise en compte d'agrégats pondérés confère plus de cohérence à la politique.