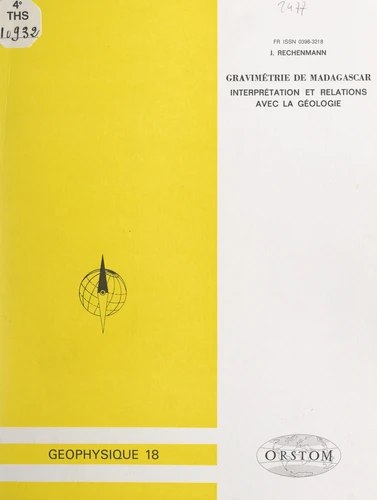Gravimétrie de Madagascar : interprétation et relations avec la géologie
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format ePub est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages135
- FormatePub
- ISBN2-307-04195-8
- EAN9782307041955
- Date de parution01/01/1982
- Protection num.Digital Watermarking
- ÉditeurFeniXX réédition numérique (Édit...
Résumé
Après un rappel de quelques notions d'ordre général sur la morphologie, la géologie, et la tectonique de Madagascar, l'auteur expose, dans une première partie, l'historique des mesures, les méthodes classiques du calcul des anomalies, et la précision des résultats. Un chapitre important est consacré à la précision de la méthode du nivellement barométrique utilisé pour la détermination des altitudes des stations.
Les relations entre anomalies et altitudes sont ensuite étudiées sous leurs différents aspects : valeurs moyennes, valeurs point par point.
; puis les cartes gravimétriques (Bouguer, isostatique) sont examinées dans leur ensemble. Dans une troisième partie, on examine - région par région - les anomalies les plus notables et leurs relations avec la géologie. De ces études, c'est la côte Est qui ressort comme le point le plus intéressant. Le modèle proposé pour interpréter l'anomalie gravimétrique de cette région, est basé sur un passage brutal par faille quasi verticale d'une croûte continentale à une croûte océanique, alors que l'interprétation des anomalies de la côte Ouest conduit à admettre une croûte à caractère continental sous le canal de Mozambique, et un effondrement à l'origine de celui-ci. En conclusion, sont abordés les problèmes relatifs à Madagascar et sa place dans le Sud-Ouest de l'océan Indien : dérive de Madagascar vers le S E à la fin du Paléozoïque, puis dislocation du Gondwana, avec décrochement de la partie orientale vers le Nord par une faille de coulissement déterminant la grande fracture de la côte Est.
; puis les cartes gravimétriques (Bouguer, isostatique) sont examinées dans leur ensemble. Dans une troisième partie, on examine - région par région - les anomalies les plus notables et leurs relations avec la géologie. De ces études, c'est la côte Est qui ressort comme le point le plus intéressant. Le modèle proposé pour interpréter l'anomalie gravimétrique de cette région, est basé sur un passage brutal par faille quasi verticale d'une croûte continentale à une croûte océanique, alors que l'interprétation des anomalies de la côte Ouest conduit à admettre une croûte à caractère continental sous le canal de Mozambique, et un effondrement à l'origine de celui-ci. En conclusion, sont abordés les problèmes relatifs à Madagascar et sa place dans le Sud-Ouest de l'océan Indien : dérive de Madagascar vers le S E à la fin du Paléozoïque, puis dislocation du Gondwana, avec décrochement de la partie orientale vers le Nord par une faille de coulissement déterminant la grande fracture de la côte Est.
Après un rappel de quelques notions d'ordre général sur la morphologie, la géologie, et la tectonique de Madagascar, l'auteur expose, dans une première partie, l'historique des mesures, les méthodes classiques du calcul des anomalies, et la précision des résultats. Un chapitre important est consacré à la précision de la méthode du nivellement barométrique utilisé pour la détermination des altitudes des stations.
Les relations entre anomalies et altitudes sont ensuite étudiées sous leurs différents aspects : valeurs moyennes, valeurs point par point.
; puis les cartes gravimétriques (Bouguer, isostatique) sont examinées dans leur ensemble. Dans une troisième partie, on examine - région par région - les anomalies les plus notables et leurs relations avec la géologie. De ces études, c'est la côte Est qui ressort comme le point le plus intéressant. Le modèle proposé pour interpréter l'anomalie gravimétrique de cette région, est basé sur un passage brutal par faille quasi verticale d'une croûte continentale à une croûte océanique, alors que l'interprétation des anomalies de la côte Ouest conduit à admettre une croûte à caractère continental sous le canal de Mozambique, et un effondrement à l'origine de celui-ci. En conclusion, sont abordés les problèmes relatifs à Madagascar et sa place dans le Sud-Ouest de l'océan Indien : dérive de Madagascar vers le S E à la fin du Paléozoïque, puis dislocation du Gondwana, avec décrochement de la partie orientale vers le Nord par une faille de coulissement déterminant la grande fracture de la côte Est.
; puis les cartes gravimétriques (Bouguer, isostatique) sont examinées dans leur ensemble. Dans une troisième partie, on examine - région par région - les anomalies les plus notables et leurs relations avec la géologie. De ces études, c'est la côte Est qui ressort comme le point le plus intéressant. Le modèle proposé pour interpréter l'anomalie gravimétrique de cette région, est basé sur un passage brutal par faille quasi verticale d'une croûte continentale à une croûte océanique, alors que l'interprétation des anomalies de la côte Ouest conduit à admettre une croûte à caractère continental sous le canal de Mozambique, et un effondrement à l'origine de celui-ci. En conclusion, sont abordés les problèmes relatifs à Madagascar et sa place dans le Sud-Ouest de l'océan Indien : dérive de Madagascar vers le S E à la fin du Paléozoïque, puis dislocation du Gondwana, avec décrochement de la partie orientale vers le Nord par une faille de coulissement déterminant la grande fracture de la côte Est.