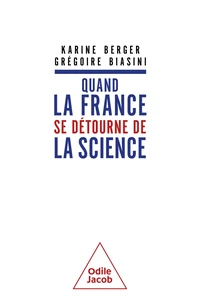- Accueil /
- Grégoire Biasini
Grégoire Biasini
Grégoire Biasini, fondateur du cabinet de conseil Palomar, conseille les organisations sur les sujets d'acceptabilité (de projets ou d'innovation) ayant des dimensions sanitaires et environnementales. Il enseigne sur des thématiques comme l'acceptabilité ou la parole scientifique (à Sciences-Po, HEC, X ou aux Arts et Métiers) et forme les dirigeants à la gestion de crise.
Grégoire Biasini, fondateur du cabinet de conseil Palomar, conseille les organisations sur les sujets d'acceptabilité (de projets ou d'innovation) ayant des dimensions sanitaires et environnementales. Il enseigne sur des thématiques comme l'acceptabilité ou la parole scientifique (à Sciences-Po, HEC, X ou aux Arts et Métiers) et forme les dirigeants à la gestion de crise.
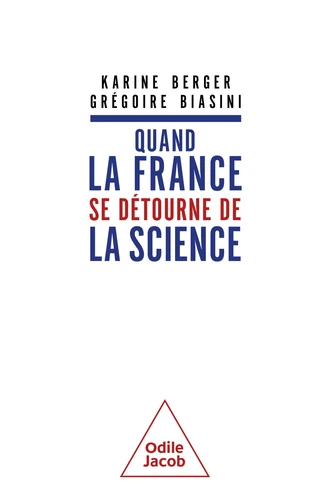
Dernière sortie
Quand la France se détourne de la science
Comment est-il possible qu'au pays de Descartes, au pays des lumières où prévaut la conception de la laïcité la plus exigeante au monde, la science et la raison soient à ce point remises en cause, relativisées, voire marginalisées ? N'est-ce pas en France que le mouvement " antivax " a pris le plus d'ampleur avant le covid ? N'est-ce pas également dans notre pays que le rejet des OGM a été le plus massif au point qu'il n'est plus possible de réouvrir le débat sur des techniques de génétique moins intrusives ? Ce phénomène de " dé-science " a de graves conséquences.
Il entraîne un désintérêt collectif pour la recherche, le savoir scientifique et l'invention du futur. Il fragilise le fonctionnement démocratique car le socle de nos opinions est de moins en moins la vérité décrite par la science, et de plus en plus la ligne politique à laquelle on s'identifie ou la post-vérité des populismes et des réseaux sociaux. Après un état des lieux bien fait et richement illustré, les auteurs montrent que si le niveau des mathématiques en France est particulièrement faible ou si les médias grand public font plus de place à la cuisine qu'à la science (! ), il s'agit là plus d'une conséquence - celle de nos choix collectifs - que d'une cause.
D'où la nécessité d'un volontarisme politique pour changer nos préférences collectives et retrouver le chemin de la confiance sans laquelle aucune communauté humaine ne peut durablement vivre ensemble.
Il entraîne un désintérêt collectif pour la recherche, le savoir scientifique et l'invention du futur. Il fragilise le fonctionnement démocratique car le socle de nos opinions est de moins en moins la vérité décrite par la science, et de plus en plus la ligne politique à laquelle on s'identifie ou la post-vérité des populismes et des réseaux sociaux. Après un état des lieux bien fait et richement illustré, les auteurs montrent que si le niveau des mathématiques en France est particulièrement faible ou si les médias grand public font plus de place à la cuisine qu'à la science (! ), il s'agit là plus d'une conséquence - celle de nos choix collectifs - que d'une cause.
D'où la nécessité d'un volontarisme politique pour changer nos préférences collectives et retrouver le chemin de la confiance sans laquelle aucune communauté humaine ne peut durablement vivre ensemble.
Comment est-il possible qu'au pays de Descartes, au pays des lumières où prévaut la conception de la laïcité la plus exigeante au monde, la science et la raison soient à ce point remises en cause, relativisées, voire marginalisées ? N'est-ce pas en France que le mouvement " antivax " a pris le plus d'ampleur avant le covid ? N'est-ce pas également dans notre pays que le rejet des OGM a été le plus massif au point qu'il n'est plus possible de réouvrir le débat sur des techniques de génétique moins intrusives ? Ce phénomène de " dé-science " a de graves conséquences.
Il entraîne un désintérêt collectif pour la recherche, le savoir scientifique et l'invention du futur. Il fragilise le fonctionnement démocratique car le socle de nos opinions est de moins en moins la vérité décrite par la science, et de plus en plus la ligne politique à laquelle on s'identifie ou la post-vérité des populismes et des réseaux sociaux. Après un état des lieux bien fait et richement illustré, les auteurs montrent que si le niveau des mathématiques en France est particulièrement faible ou si les médias grand public font plus de place à la cuisine qu'à la science (! ), il s'agit là plus d'une conséquence - celle de nos choix collectifs - que d'une cause.
D'où la nécessité d'un volontarisme politique pour changer nos préférences collectives et retrouver le chemin de la confiance sans laquelle aucune communauté humaine ne peut durablement vivre ensemble.
Il entraîne un désintérêt collectif pour la recherche, le savoir scientifique et l'invention du futur. Il fragilise le fonctionnement démocratique car le socle de nos opinions est de moins en moins la vérité décrite par la science, et de plus en plus la ligne politique à laquelle on s'identifie ou la post-vérité des populismes et des réseaux sociaux. Après un état des lieux bien fait et richement illustré, les auteurs montrent que si le niveau des mathématiques en France est particulièrement faible ou si les médias grand public font plus de place à la cuisine qu'à la science (! ), il s'agit là plus d'une conséquence - celle de nos choix collectifs - que d'une cause.
D'où la nécessité d'un volontarisme politique pour changer nos préférences collectives et retrouver le chemin de la confiance sans laquelle aucune communauté humaine ne peut durablement vivre ensemble.