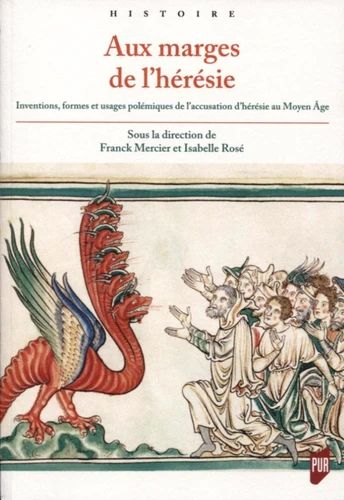Aux marges de l'hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Age
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages384
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.636 kg
- Dimensions16,4 cm × 24,0 cm × 2,9 cm
- ISBN978-2-7535-5904-2
- EAN9782753559042
- Date de parution18/01/2018
- CollectionHistoire
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Si l'histoire traditionnelle de l'hérésie au Moyen Age s'est longtemps confondue avec celle des exclus de la société, l'approche récente se focalise davantage sur les diverses autorités qui, au coeur du pouvoir, élaborèrent la norme religieuse : l'hérésie n'existe que parce que l'orthodoxie en a d'abord décidé. Il reste que, loin de se présenter comme une essence immuable, elle s'impose tout au long du Moyen Age comme un concept et une qualification d'une très grande plasticité.
L'extension progressive du domaine de l'hérésie à de nombreuses formes de dissidence finit par lui assurer le statut d'un crime englobant. Cette enquête collective repose sur la conviction que c'est encore en se situant aux marges de l'hérésie, au contact d'activités répréhensibles voisines, telles que l'usure, la sorcellerie ou encore la rébellion politique, que l'on peut le mieux saisir les principes et les mécanismes de la fabrique de l'hérésie.
Avec le soutien du laboratoire TEMPORA de l'université Rennes 2, du GIS Hépos (Hérésie, Pouvoirs et Sociétés - Antiquité, Moyen âge, époque moderne) et du CERHIO de l'université Rennes 2
L'extension progressive du domaine de l'hérésie à de nombreuses formes de dissidence finit par lui assurer le statut d'un crime englobant. Cette enquête collective repose sur la conviction que c'est encore en se situant aux marges de l'hérésie, au contact d'activités répréhensibles voisines, telles que l'usure, la sorcellerie ou encore la rébellion politique, que l'on peut le mieux saisir les principes et les mécanismes de la fabrique de l'hérésie.
Avec le soutien du laboratoire TEMPORA de l'université Rennes 2, du GIS Hépos (Hérésie, Pouvoirs et Sociétés - Antiquité, Moyen âge, époque moderne) et du CERHIO de l'université Rennes 2
Si l'histoire traditionnelle de l'hérésie au Moyen Age s'est longtemps confondue avec celle des exclus de la société, l'approche récente se focalise davantage sur les diverses autorités qui, au coeur du pouvoir, élaborèrent la norme religieuse : l'hérésie n'existe que parce que l'orthodoxie en a d'abord décidé. Il reste que, loin de se présenter comme une essence immuable, elle s'impose tout au long du Moyen Age comme un concept et une qualification d'une très grande plasticité.
L'extension progressive du domaine de l'hérésie à de nombreuses formes de dissidence finit par lui assurer le statut d'un crime englobant. Cette enquête collective repose sur la conviction que c'est encore en se situant aux marges de l'hérésie, au contact d'activités répréhensibles voisines, telles que l'usure, la sorcellerie ou encore la rébellion politique, que l'on peut le mieux saisir les principes et les mécanismes de la fabrique de l'hérésie.
Avec le soutien du laboratoire TEMPORA de l'université Rennes 2, du GIS Hépos (Hérésie, Pouvoirs et Sociétés - Antiquité, Moyen âge, époque moderne) et du CERHIO de l'université Rennes 2
L'extension progressive du domaine de l'hérésie à de nombreuses formes de dissidence finit par lui assurer le statut d'un crime englobant. Cette enquête collective repose sur la conviction que c'est encore en se situant aux marges de l'hérésie, au contact d'activités répréhensibles voisines, telles que l'usure, la sorcellerie ou encore la rébellion politique, que l'on peut le mieux saisir les principes et les mécanismes de la fabrique de l'hérésie.
Avec le soutien du laboratoire TEMPORA de l'université Rennes 2, du GIS Hépos (Hérésie, Pouvoirs et Sociétés - Antiquité, Moyen âge, époque moderne) et du CERHIO de l'université Rennes 2