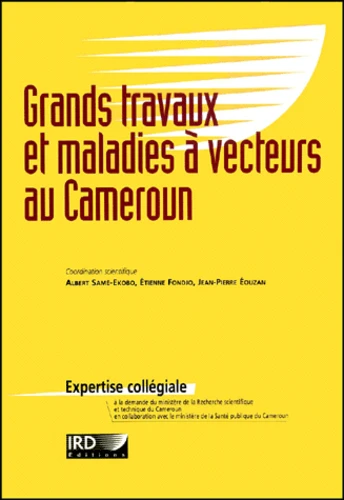Grands Travaux Et Maladies A Vecteurs Au Cameroun. Impact Des Amenagements Ruraux Et Urbains Sur Le Paludisme Et Autres Maladies A Vecteurs
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages221
- PrésentationBroché
- Poids0.235 kg
- Dimensions14,8 cm × 21,1 cm × 1,0 cm
- ISBN2-7099-1482-4
- EAN9782709914826
- Date de parution13/12/2001
- CollectionExpertise collégiale
- ÉditeurIRD Orstom
Résumé
Au début du XXIe siècle, le paludisme demeure la première cause de mortalité et de morbidité au Cameroun, comme dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne. Mais pour tout programme de lutte de grande envergure, une analyse de situation de l'endémie se révèle indispensable, comme le souligne l'OMS dans sa nouvelle initiative " Faire reculer le paludisme " ou " Roll back malaria ". C'est pour répondre à cette préoccupation qu'a été menée la présente expertise collégiale. Celle-ci fournit une revue complète de la littérature consacrée à l'impact des projets de développement et des grands aménagements urbains sur l'endémie palustre et sur les autres maladies vectorielles liées à l'eau. Au Cameroun, on constate une dilution des cas de paludisme et de bilharziose en milieu urbain, une stabilisation du paludisme dans l'environnement des périmètres rizicoles, de même qu'une progression des indices onchocerquiens dans les localités proches des chutes d'eau et des rapides ainsi que leur recul en aval, suite au changement du régime des eaux. Mais au-delà de l'exemple camerounais, il ressort de cette expertise que dans tout pays où sévissent les maladies endémiques liées à l'eau, la question de l'impact sanitaire des aménagements hydrauliques et hydro-agricoles doit être posée dès le stade de la conception d'un projet, mais également lors de sa mise en œuvre et pendant toute sa phase d'exploitation. Ingénieurs, économistes, agents des services spécialisés de santé et d'éducation, sociologues, tous les acteurs du développement doivent œuvrer ensemble et rester en dialogue permanent avec les communautés concernées. Telle est la condition pour que les populations bénéficient pleinement et sans contrepartie des retombées économiques et sociales attendues de tels projets.
Au début du XXIe siècle, le paludisme demeure la première cause de mortalité et de morbidité au Cameroun, comme dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne. Mais pour tout programme de lutte de grande envergure, une analyse de situation de l'endémie se révèle indispensable, comme le souligne l'OMS dans sa nouvelle initiative " Faire reculer le paludisme " ou " Roll back malaria ". C'est pour répondre à cette préoccupation qu'a été menée la présente expertise collégiale. Celle-ci fournit une revue complète de la littérature consacrée à l'impact des projets de développement et des grands aménagements urbains sur l'endémie palustre et sur les autres maladies vectorielles liées à l'eau. Au Cameroun, on constate une dilution des cas de paludisme et de bilharziose en milieu urbain, une stabilisation du paludisme dans l'environnement des périmètres rizicoles, de même qu'une progression des indices onchocerquiens dans les localités proches des chutes d'eau et des rapides ainsi que leur recul en aval, suite au changement du régime des eaux. Mais au-delà de l'exemple camerounais, il ressort de cette expertise que dans tout pays où sévissent les maladies endémiques liées à l'eau, la question de l'impact sanitaire des aménagements hydrauliques et hydro-agricoles doit être posée dès le stade de la conception d'un projet, mais également lors de sa mise en œuvre et pendant toute sa phase d'exploitation. Ingénieurs, économistes, agents des services spécialisés de santé et d'éducation, sociologues, tous les acteurs du développement doivent œuvrer ensemble et rester en dialogue permanent avec les communautés concernées. Telle est la condition pour que les populations bénéficient pleinement et sans contrepartie des retombées économiques et sociales attendues de tels projets.