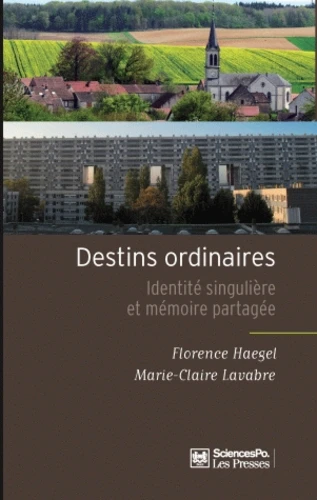Destins ordinaires. Identité singulière et mémoire partagée
Par : ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF protégé est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
- Non compatible avec un achat hors France métropolitaine
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages144
- FormatPDF
- ISBN978-2-7246-8327-1
- EAN9782724683271
- Date de parution01/02/2010
- Copier CollerNon Autorisé
- Protection num.Adobe DRM
- Taille6 Mo
- Transferts max.6 copie(s) autorisée(s)
- ÉditeurPresses de Sciences Po
Résumé
La forme de cet ouvrage est inhabituelle. Deux histoires en constituent la trame : celle d'une femme, habitante d'une cité dite "difficile" de la banlieue parisienne, et celle, racontée par trois générations, d'une famille, dite "ordinaire", issue du monde rural. A travers ces deux récits, c'est la question, centrale, des effets des transformations de la société française sur le rapport au politique des individus qui se trouve posée.
Comment se compose, à l'échelle d'un individu, une identité problématique ? Quels sont les mécanismes de transmission entre générations ? En quoi le politique intervient-il dans l'éventuelle constitution dune identité singulière ou dune mémoire familiale ? En sinterrogeant sur les phénomènes de socialisation politique, les auteures mettent à l'épreuve les notions didentité et de mémoire, couramment utilisées, si ce n'est galvaudées, dans le débat public et scientifique.
En privilégiant le cadre de lindividu, elles tentent de comprendre les formes dindétermination et les marges de manoeuvre qui accompagnent, voire autorisent, adaptations et mutations. Au-delà, cette expérimentation par l'exemple des attendus de l'étude de cas en sociologie politique illustre plus largement les exigences, les enjeux et les possibles apports dun travail fondé sur des matériaux qualitatifs.
Florence Haegel et Marie-Claire Lavabre sont directrices de recherche au Centre détudes européennes (Sciences Po, CNRS)
Comment se compose, à l'échelle d'un individu, une identité problématique ? Quels sont les mécanismes de transmission entre générations ? En quoi le politique intervient-il dans l'éventuelle constitution dune identité singulière ou dune mémoire familiale ? En sinterrogeant sur les phénomènes de socialisation politique, les auteures mettent à l'épreuve les notions didentité et de mémoire, couramment utilisées, si ce n'est galvaudées, dans le débat public et scientifique.
En privilégiant le cadre de lindividu, elles tentent de comprendre les formes dindétermination et les marges de manoeuvre qui accompagnent, voire autorisent, adaptations et mutations. Au-delà, cette expérimentation par l'exemple des attendus de l'étude de cas en sociologie politique illustre plus largement les exigences, les enjeux et les possibles apports dun travail fondé sur des matériaux qualitatifs.
Florence Haegel et Marie-Claire Lavabre sont directrices de recherche au Centre détudes européennes (Sciences Po, CNRS)
La forme de cet ouvrage est inhabituelle. Deux histoires en constituent la trame : celle d'une femme, habitante d'une cité dite "difficile" de la banlieue parisienne, et celle, racontée par trois générations, d'une famille, dite "ordinaire", issue du monde rural. A travers ces deux récits, c'est la question, centrale, des effets des transformations de la société française sur le rapport au politique des individus qui se trouve posée.
Comment se compose, à l'échelle d'un individu, une identité problématique ? Quels sont les mécanismes de transmission entre générations ? En quoi le politique intervient-il dans l'éventuelle constitution dune identité singulière ou dune mémoire familiale ? En sinterrogeant sur les phénomènes de socialisation politique, les auteures mettent à l'épreuve les notions didentité et de mémoire, couramment utilisées, si ce n'est galvaudées, dans le débat public et scientifique.
En privilégiant le cadre de lindividu, elles tentent de comprendre les formes dindétermination et les marges de manoeuvre qui accompagnent, voire autorisent, adaptations et mutations. Au-delà, cette expérimentation par l'exemple des attendus de l'étude de cas en sociologie politique illustre plus largement les exigences, les enjeux et les possibles apports dun travail fondé sur des matériaux qualitatifs.
Florence Haegel et Marie-Claire Lavabre sont directrices de recherche au Centre détudes européennes (Sciences Po, CNRS)
Comment se compose, à l'échelle d'un individu, une identité problématique ? Quels sont les mécanismes de transmission entre générations ? En quoi le politique intervient-il dans l'éventuelle constitution dune identité singulière ou dune mémoire familiale ? En sinterrogeant sur les phénomènes de socialisation politique, les auteures mettent à l'épreuve les notions didentité et de mémoire, couramment utilisées, si ce n'est galvaudées, dans le débat public et scientifique.
En privilégiant le cadre de lindividu, elles tentent de comprendre les formes dindétermination et les marges de manoeuvre qui accompagnent, voire autorisent, adaptations et mutations. Au-delà, cette expérimentation par l'exemple des attendus de l'étude de cas en sociologie politique illustre plus largement les exigences, les enjeux et les possibles apports dun travail fondé sur des matériaux qualitatifs.
Florence Haegel et Marie-Claire Lavabre sont directrices de recherche au Centre détudes européennes (Sciences Po, CNRS)